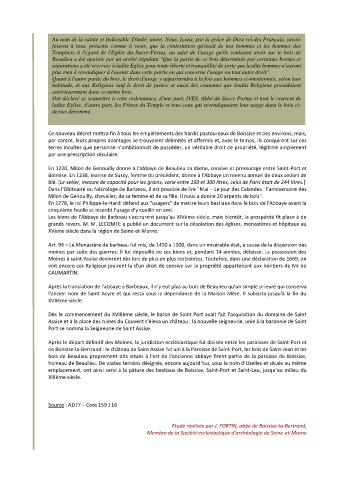Page 6 - Notice de l'Abbaye
P. 6
Au nom de la sainte et Indivisible Trinité, amen. Nous, Louis, par la grâce de Dieu roi des Français, savoir
faisons à tous, présents comme à venir, que la contestation qu'avait de nos hommes et les hommes des
Templiers à l'égard de l'Eglise du Sacer-Portus, au sujet de l'usage qu'ils voulaient avoir sur le bois de
Beaulieu a été apaisée par un arrêté stipulant "Que la partie de ce bois déterminée par certaines bornes et
séparations a été réservée à ladite Eglise pour toute liberté et tranquillité de sorte que lesdits hommes n'auront
plus rien à revendiquer à l'avenir dans cette partie en qui concerne l'usage ou tout autre droit".
Quant à l'autre partie du bois, le droit d'usage y appartiendra à la fois aux hommes ci-mentionnés, selon leur
habitude, et aux Religieux sauf le droit de justice et aussi des coutumes que lesdits Religieux possédaient
antérieurement dans ce même bois.
Ont déclaré se soumettre à cette ordonnance, d'une part, IVES, Abbé du Sacer-Portus et tout le couvent de
ladite Eglise, d'autre part, les Frères du Temple et tous ceux qui revendiquaient leur usage dans le bois ci-
dessus dénommé.
Ce nouveau décret mettra fin à tous les empiètements des hardis pastoureaux de Boissise et des environs, mais,
par contre, leurs propres avantages se trouvaient délimités et affermis et, avec le temps, ils conquirent sur ces
terres incultes que personne n'ambitionnait de posséder, un véritable droit de propriété, légitimé amplement
par une prescription séculaire.
En 1220, Milon de Genouilly donne à l'abbaye de Beaulieu sa dixme, censive et pressurage entre Saint-Port et
Boissise. En 1238, Jeanne de Suscy, femme du précédent, donne à l'Abbaye un revenu annuel de deux setiers de
blé. [Le setier, mesure de capacité pour les grains, varie entre 150 et 300 litres, celui de Paris était de 244 litres.]
Dans l'Obituaire ou Nécrologe de Barbeau, il est possible de lire "Mai – Le jour des Calandes : l'anniversaire des
Milon de Genouilly, chevalier, de sa femme et de sa fille. Il nous a donné 20 arpents de bois".
En 1278, le roi Philippe-le-Hardi défend aux "usagers" de mettre leurs bestiaux dans le bois de l'Abbaye avant la
cinquième feuille et interdit l'usage d'y cueillir en ami.
Les biens de l'Abbaye de Barbeau s'accrurent jusqu'au XIVème siècle, mais bientôt, la prospérité fit place à de
grands revers. M. M. LECOMTE a publié un document sur la désolation des églises, monastères et hôpitaux au
XVème siècle dans la région de Seine-et-Marne.
Art. 94 – Le Monastère de barbeau fut mis, de 1450 à 1500, dans un misérable état, à cause de la dispersion des
moines par suite des guerres. Il fut dépouillé de ses biens et, pendant 14 années, délaissé. La possession des
Moines à saint-Assise devinrent dès lors de plus en plus restreintes. Toutefois, dans une déclaration de 1669, on
voit encore ces Religieux jouirent la d'un droit de censive sur la propriété appartenant aux héritiers de Mr de
CAUMARTIN.
Après la translation de l'abbaye à Barbeaux, il n'y eut plus au bois de Beaulieu qu'un simple prieuré qui conserva
l'ancien nom de Saint Acyre et qui resta sous la dépendance de la Maison Mère. Il subsista jusqu'à la fin du
XVIIème siècle.
Dès le commencement du XVIIIème siècle, le baron de Saint Port avait fait l'acquisition du domaine de Saint
Assise et à la place des ruines du Couvent s'éleva un château : la nouvelle seigneurie, unie à la baronnie de Saint
Port se nomma la Seigneurie de Saint Assise.
Après le départ définitif des Moines, la juridiction ecclésiastique fut divisée entre les paroisses de Saint-Port et
de Boissise-la-Bertrand : le château de Saint Assise fut uni à la Paroisse de Saint-Port, les bois de Saint-Jean et les
bois de Beaulieu proprement dits situés à l'est de l'ancienne abbaye firent partie de la paroisse de Boissise,
hameau de Beaulieu. De vastes terrains désignés, encore aujourd'hui, sous le nom d'Uzelles et situés au même
emplacement, ont ainsi servi à la pâture des bestiaux de Boissise, Saint-Port et Saint-Leu, jusqu’au milieu du
XIXème siècle.
Source : AD77 – Cote 159 J 16
Etude réalisée par J. FORTIN, abbé de Boissise-la-Bertrand,
Membre de la Société ecclésiastique d'archéologie de Seine-et-Marne